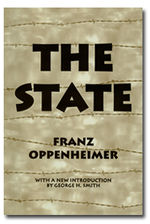Si nous comprenons ici encore par « fins » une évolution organique, progressive ou régressive, de l'Etat Féodal Développé, évolution déterminée par des forces intérieures, et non une fin amenée mécaniquement et causée par des forces extérieures, nous pouvons dire que la fin de l'Etat est déterminée uniquement par le développement indépendant des institutions sociales fondées par le moyen économique.
Des influences analogues peuvent venir aussi de l'extérieur, d'Etats étrangers possédant un développement économique plus avancé et par suite une centralisation plus rigide, une meilleure organisation militaire et une plus puissante force de propulsion. Nous avons déjà mentionné de tels cas : le développement indépendant des Etats Féodaux méditerranéens a été arrêté par leur collision avec les Etats maritimes beaucoup plus riches et plus rigoureusement centralisés de Carthage et surtout de Rome. La destruction de l'empire des Perses par Alexandre rentre aussi dans cette catégorie de faits, la Macédoine s'étant déjà assimilé à cette époque les acquisitions économiques des Etats maritimes hellènes. Le meilleur exemple de l'action de ces influences étrangères est le sort du Japon moderne dont l'évolution a été précipitée de façon presque incroyable par l'action militaire et économique de la civilisation occidentale. En une génération à peine il a parcouru la distance séparant l'Etat Féodal Développé de l'Etat constitutionnel moderne entièrement organisé.
Il ne s'agit ici, ce me semble, que d'une abréviation du processus. Autant qu'il est possible d'en juger, – car l'histoire ne nous offre maintenant que peu de données à l'appui et l'ethnographie moins encore, – les forces intérieures, même sans l'intervention de puissantes influences étrangères, doivent inévitablement conduire l'Etat Féodal Développé par le même chemin vers la même fin.
Les créations du moyen économique qui gouvernent cette évolution sont l'organisation urbaine et sa création essentielle, l'économie monétaire, qui refoule peu à peu l'économie naturelle et déplace ainsi l'axe autour duquel se meut toute la vie de l'Etat : le capital foncier cède graduellement la place au capital mobilier.
Emancipation de la classe paysanne
Tout ce qui précède résulte nécessairement des conditions fondamentales de l'Etat naturel Féodal. A mesure que la grande propriété foncière se transforme en souveraineté, l'économie féodale naturelle disparaît.
En effet tant que la grande propriété foncière est relativement peu étendue il est possible de maintenir le principe primitif de l'apiculteur, laissant au paysan le strict nécessaire ; mais lorsqu'elle s'étend de plus en plus et, ce qui est généralement le cas, qu'elle embrasse des possessions éparpillées sur des territoires éloignés, acquises par les guerres, « commendationes[1] » de petits propriétaires, héritages ou alliances politiques, ce régime devient impossible. Si le propriétaire ne veut pas payer une foule de fonctionnaires subalternes, méthode non seulement coûteuse mais aussi dangereuse politiquement, il n’a qu’une ressource : imposer au paysan une redevance fixe, moitié rente, moitié taxe. La nécessité économique d'une réforme administrative coïncide ainsi avec la nécessité politique de l'élévation de la « plèbe » que nous avons observée déjà.
A mesure que le propriétaire cesse d'être un sujet économique d'ordre privé pour devenir exclusivement un sujet légal d’ordre public, c'est-à-dire un souverain, la solidarité que nous avons déjà mentionnée s'affirme entre lui et le peuple. Nous avons vu que dès la période de transition menant la grande propriété foncière à la principauté, les magnats isolés avaient le plus grand intérêt à établir un régime bénin, non seulement afin d'élever la plèbe au sentiment patriotique, mais aussi pour faciliter aux hommes francs le passage au servage et dérober aux voisins et rivaux le précieux matériel humain. Ce même intérêt commande urgemment au souverain parvenu à la pleine indépendance de persévérer dans cette voie. Son intérêt politique, lorsqu'il baille des fiefs à ses fonctionnaires et officiers, est avant tout de ne pas leur livrer les sujets pieds et poings liés. Pour les garder sous sa domination il restreint le droit d'aide des chevaliers à des redevances fixes en nature et à des corvées déterminées, et se réserve les autres droits d'ordre politique (droits de péage, etc...). Le fait que le paysan paie désormais tribut à deux maîtres au moins a une importance énorme pour le cours de son élévation ultérieure.
Le paysan dans l'Etat Féodal Développé ne doit donc plus que des redevances fixes : tout excédent lui appartient en propre. Le caractère de la propriété foncière se trouve bouleversé par là de fond en comble : pendant que jusque-là la totalité du produit revenait légalement, au maître déduction faite de l'entretien à peine suffisant du cultivateur, le produit appartient maintenant à ce dernier, déduction faite d'une rente fixe à payer au propriétaire. La grande propriété foncière est devenue seigneurie ; c'est le second grand pas accompli par l'humanité vers son but ultime. Le premier fut la transformation de l'Etat-Ours en Etat-Apiculteur : il institua l'esclavage que le second supprime. Le travailleur, jusque-là uniquement objet légal est devenu pour la première fois sujet légal. Le moteur à travail dépourvu de droits, ne possédant qu'une faible garantie d'existence, la chose de son maître, est maintenant le sujet contribuable d'un prince.
Dès lors le moyen économique assuré du succès final va déployer toutes ses forces. Le paysan travaille avec infiniment plus d'énergie et de soin, obtient un excédent, et par là est créée la ville au sens strictement économique du mot, la ville industrielle. Le paysan porte ses produits sur le marché – en d'autres termes il exécute une demande de ces biens industriels qu'il ne produit plus lui-même. Travaillant avec une plus grande intensité, il n'a plus le temps nécessaire pour produire les différents biens qu'il fabriquait jusque-là avec sa famille. La division du travail entre la production de matières premières et l'industrie devient possible et même nécessaire : le village est principalement le siège de la première, la ville industrielle se fonde comme siège de la seconde.
Naissance de la ville industrielle
Que l'on ne se méprenne pas ! Ce n'est pas la ville qui est fondée mais la ville industrielle. La véritable ville historique existe depuis longtemps et ne manque dans aucun Etat Féodal Développé. Elle tire son origine soit du moyen politique seul, comme château fort, soit de l'association des moyens politiques et économiques, comme foire, soit du besoin religieux comme territoire d'Eglise[2]. Lorsque de telles villes au sens historique ou mot se trouvent dans le voisinage, la ville industrielle se greffe sur elles : autrement elle surgit spontanément comme produit de la division du travail désormais organisée, et se développe le plus souvent à son tour comme château fort et lieu de culte.
Ce ne sont là toutefois que des additions historiques fortuites. Au sens strict du mot la ville est le siège du moyen économique, du mouvement d’échange entre la production agricole et l'industrie. L'usage même du mot confirme notre assertion : une forteresse, quelque importante qu'elle soit, un amoncellement de temples, de cloîtres, de lieux de pèlerinage, fussent-ils même concevables sans marché, ne peuvent pas encore être appelés des « villes ».
Si l'aspect extérieur de la ville historique a relativement peu changé, sa transformation intérieure est d'autant plus considérable. La ville industrielle est l'antipode et l’adversaire née de l'Etat : il est le moyen politique, elle est le moyen économique en plein développement. La grande lutte qui remplit les pages de l'histoire universelle, qui est cette histoire même, se livre désormais entre la ville et l'Etat.
La ville, en tant que corps politique et économique, emploie pour combattre le système féodal des armes politiques et économiques : avec les premières elle arrache, avec les secondes elle dérobe le pouvoir à la classe dominatrice de la féodalité. Ce processus a lieu sur le terrain politique de la manière suivante : la ville, centre de pouvoir indépendant, intervient dans le jeu des forces faisant mouvoir l'Etat féodal ; elle se dresse et s'immisce comme quatrième force entre le pouvoir central, les seigneurs locaux et les sujets. En tant que forteresses et domiciles de gens de guerre, dépôts d'instruments militaires, d'armes, etc., et plus tard comme centres d'économie monétaire, les villes sont de précieux soutiens et alliés dans les combats entre le pouvoir central et les futurs princes souverains, de même que dans les luttes entre ces derniers et elles peuvent, par une adroite politique, obtenir de précieux privilèges.
Dans ces combats les villes sont généralement avec le pouvoir central contre les seigneurs féodaux ; pour des raisons sociales d'abord, le noble refusant de reconnaître au patricien dans les rapports sociaux l'égalité que ce dernier exige au nom de sa richesse supérieure ; puis, pour des raisons politiques, le pouvoir central, grâce à la solidarité existant entre le prince et le peuple, considérant l'intérêt commun bien plus que ne le fait le grand propriétaire foncier, recherchant uniquement ses intérêts privés ; et enfin pour des raisons économiques, la prospérité de la ville étant étroitement liée à la paix et la sécurité publique. Entre le droit du plus fort et le moyen économique règne une irrévocable incompatibilité. C'est pourquoi les villes restent en général attachées au protecteur de la paix et de la légalité : à l'empereur, au souverain. Et lorsque les milices municipales détruisent et rasent un repaire de brigands ce n'est que le reflet en infiniment petit de la gigantesque opposition qui gouverne l'histoire du monde.
Afin de pouvoir remplir avec succès ce rôle historique la ville doit attirer dans ses murs le plus grand nombre possible d'habitants, tendance justifiée aussi par des considérations d'ordre purement économique. Avec le nombre des citoyens augmente la division du travail et aussi la richesse. C'est pourquoi la ville encourage l'immigration de toutes ses forces, démontrant ainsi une fois de plus l'antagonisme absolu qui existe entre elle et le seigneur féodal. Les nouveaux citoyens qu'elle attire sont arrachés aux domaines, aux possessions féodales qui vont s'affaiblissant en forces, en contribuables et en militaires à mesure que la ville se fortifie. Cette dernière intervient comme amateur dans cette vente aux enchères où le paysan-serf est adjugé au plus offrant, à celui qui offre le plus d'avantages et de droits. La ville offre liberté entière, parfois même maison et terrain. L'axiome « l'air des villes rend libre » est défendu victorieusement et le pouvoir central, ravi de fortifier les villes en affaiblissant les nobles rebelles, appose volontiers son sceau sous le droit nouvellement institué.
C'est le troisième grand progrès accompli au cours de l'histoire du monde : la dignité du travail libre est découverte ou plutôt elle est retrouvée : elle était tombée en oubli depuis ces temps reculés où le chasseur indépendant et le laboureur non-conquis jouissaient librement du fruit de leur labeur. Le paysan porte toujours la flétrissure du servage et son droit est bien faible encore : mais dans la ville fortifiée et bien défendue le citoyen porte haut la tête, un homme libre dans toute l'acception du mot.
Sans doute il y a encore des inégalités politiques dans l'enceinte des murs de la ville. Les anciens habitants, les descendants des chevaliers, les familles d'origine libre, les riches propriétaires refusent au nouveau venu, à l'affranchi, au pauvre artisan ou regrattier, toute participation aux affaires municipales. Mais comme nous l'avons déjà vu dans la description de l'Etat Maritime, ces rangs ne peuvent se maintenir longtemps dans l'atmosphère citadine. La majorité intelligente, sceptique, fortement organisée et unifiée conquiert finalement l'égalité des droits. La lutte dure en général plus longtemps dans l'Etat Féodal Développé, les partis n'étant plus seuls à vider leurs querelles : les grands propriétaires fonciers du voisinage et les princes interviennent comme obstacles dans le jeu des forces. Ce tertius gaudens[3] était absent dans les Etats Maritimes de l'antiquité où aucune domination féodale n'existait en dehors de la ville.
Telles sont les armes politiques de la cité dans sa lutte contre l'Etat Féodal : alliance avec la couronne, offensive directe, et attraction des serfs des campagnes dans la libre atmosphère citadine. Et son arme économique n'est pas moins puissante ; l'économie monétaire, conséquence inséparable de l'organisation urbaine, détruit de fond en comble l'Etat ne connaissant que l'économie naturelle, l'Etat Féodal.
Influences de l’économie monétaire
Le processus sociologique que l'économie monétaire met en mouvement est si connu et si généralement admis dans sa dynamique que nous nous bornerons ici à de brèves indications.
L'affermissement jusqu'à la toute puissance du pouvoir central et l'affaiblissement jusqu'à l'impuissance des autorités locales sont ici, comme dans les Etats Maritimes, les suites de l'économie monétaire envahissante.
La domination est non pas le but mais le moyen employé par les maîtres pour atteindre leur but véritable, la possession sans travail préalable de biens de jouissance en aussi grande quantité et de qualité aussi précieuse que possible. Dans l'Etat naturel le seul moyen d'arriver à la possession de ces biens est la domination : le pouvoir politique du margrave et du seigneur constitue sa richesse. Sa force offensive augmente en proportion directe du nombre de paysans sous ses ordres et son territoire de domination s'accroit dans la même proportion que ses revenus. Au contraire dès qu'un marché florissant offre, en échange des produits du sol, des marchandises précieuses et séduisantes, il est beaucoup plus rationnel pour le sujet économique d'ordre privé, c'est-à-dire pour chaque seigneur non parvenu à la souveraineté (et les gentilshommes appartiennent maintenant à cette classe), il est plus rationnel, dis-je, de restreindre dans la mesure du possible le nombre de paysans, n'en gardant qu'autant qu'il est indispensable pour extraire du sol, par un travail acharné, la plus grande quantité possible de produits, ne leur en abandonnant qu'une part réduite au strict minimum. Le « produit net », prodigieusement accru, de la propriété foncière n'est plus désormais employé à l'entretien d'une escorte militaire mais, toujours rationnellement, il est porté au marché pour y être vendu en échange de marchandises. L'escorte est supprimée, le seigneur est devenu gentilhomme campagnard. Le pouvoir central, roi, prince ou souverain est subitement débarrassé de ses rivaux : politiquement il est devenu tout-puissant. Les vassaux rebelles, qui faisaient trembler le roi-fainéant, se sont transformés après un court intermède de parlementarisme en souples courtisans prosternés devant le Roi-Soleil. Ils dépendent de lui, car seule la force militaire qu'il possède dans son armée mercenaire, peut réprimer les tentatives de soulèvement des manants poussés à bout. Tandis qu'avec l'économie naturelle la couronne était presque toujours liguée avec les paysans et les villes contre la noblesse, nous voyons maintenant l'absolutisme, issu de l'Etat Féodal, en ligue avec la noblesse contre les représentants du moyen économique.
Depuis Adam Smith il est d'usage de représenter cette transformation de telle sorte que le stupide hobereau semble avoir vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, abandonnant la domination souveraine pour d'inutiles hochets. Rien n'est plus faux que ce point de vue. L'individu s'abuse souvent dans la protection de ses intérêts : une classe ne se trompe jamais de façon permanente.
La vérité est que l'économie monétaire suffit, directement et sans l'intervention de la transformation agraire, à augmenter la force politique du pouvoir central à un tel point que toute résistance de la part de la noblesse serait insensée. Comme il ressort de l'histoire de l'antiquité, l'armée d'un pouvoir central financièrement fort est toujours de beaucoup supérieure au ban féodal. Avec de l'argent on peut équiper parfaitement de jeunes paysans et en faire des soldats de profession dont la masse compacte ne se laisse pas entamer par la troupe peu homogène de l'armée seigneuriale. De plus le prince à ce moment peut encore compter sur les bataillons aguerris des milices citadines. L'arme à feu, elle aussi un produit de l'économie industrielle de la ville florissante, a fait le reste dans l'Europe Occidentale. Pour toutes ces raisons militaires et techniques le seigneur féodal, même s'il dédaigne les jouissances du luxe et veut conserver ou étendre son indépendance relative, est forcé de faire subir à son domaine la même transformation agraire. Pour être fort en effet il lui faut d'abord de l'argent (devenu véritablement le nerf de la guerre) afin de pouvoir acheter des armes et embaucher des soldats. La révolution opérée par l'économie monétaire crée la seconde entreprise capitaliste : à côté de la grande exploitation agricole apparaît la grande entreprise militaire. Les condottieri paraissent sur la scène. Il y a désormais sur le marché du matériel mercenaire en quantité suffisante : ce sont les escortes féodales congédiées et les paysans expropriés.
De cette façon, il arrive bien parfois qu'un seigneur aventurier s'élève au rang de souverain, ainsi qu'il arriva en Italie, et même en Allemagne avec Wallenstein. Mais ce sont là des destinées individuelles qui ne changent en rien le bilan des faits. Les puissances locales comme centres autonomes du pouvoir disparaissent du terrain politique et ne conservent une dernière bribe de leur ancienne influence qu'aussi longtemps que le prince a besoin d'elles financièrement : c'est l'organisation parlementaire des Etats.
La prodigieuse augmentation de pouvoir de la couronne est encore accrue par une seconde création de l'économie monétaire : le fonctionnarisme. Nous avons dépeint en détail le cercle fatal que doit parcourir l'Etat féodal, cahoté entre l'agglomération et la désagrégation, aussi longtemps qu'il est contraint de payer ses fonctionnaires en « terres et serfs », les transformant ainsi en facteurs indépendants. L'économie monétaire a rompu ce cercle. Désormais le pouvoir central confie les charges à des employés salariés qui sont entièrement sous sa dépendance[4]. Dès lors un gouvernement fortement centralisé peut se maintenir, et des empires se forment comme l'on n'en avait plus vu depuis la chute des Etats maritimes parvenus à l'économie monétaire.
Ce changement radical de la constellation des forces politiques s'est rattaché partout, autant que j'en puis juger, au développement de l'économie monétaire, avec peut-être une exception : l'Egypte. Ici l'économie monétaire semble s'être développée seulement à l'époque hellène. D'après les égyptologues compétents (il ne peut bien entendu être question ici d'affirmation positive) le paysan jusqu'à cette époque livrait des redevances en nature[5]. Pourtant nous trouvons l'absolutisme en pleine vigueur dans le Nouvel-Empire après l'expulsion des Hyksos : « Le pouvoir militaire est fortifié par des mercenaires étrangers, l'administration est conduite au moyen de fonctionnaires sous les ordres du roi, l'aristocratie des charges a disparu[6]. »
L'exception ici confirme la règle. Géographiquement l'Egypte est une contrée unique. Etroitement resserrée entre le désert et les montagnes elle est parcourue dans toute sa longueur par une voie naturelle présentant pour le transport en masse des marchandises plus de facilités que la chaussée la mieux entretenue : le Nil. Cette voie permettait au Pharaon de centraliser dans ses magasins, dans ses « maisons[7] » les tributs de toute la contrée et de solder de là en nature fonctionnaires et soldats. C'est pourquoi l'Egypte, une fois unifiée en grande puissance, demeura centralisée jusqu'à ce que des puissances étrangères eussent mis fin à son existence politique. « La toute-puissance du souverain provient de ce que, avec une économie naturelle, il dispose directement et exclusivement de tous les biens de jouissance. Sur la totalité des revenus il prélève pour solder les fonctionnaires, autant et tels de ces biens qu'il lui semble bon : la distribution des marchandises de luxe est aussi presque exclusivement entre ses mains[8]. »
A cette exception près, exception possible seulement dans une contrée où le problème de la circulation est résolu par une unique voie fluviale, l'économie monétaire a toujours eu comme conséquence la dissolution de l'Etat Féodal.
Les paysans et les villes paient les frais de ce bouleversement. En signant la paix la couronne et les nobles se livrèrent le paysan réciproquement, le partageant pour ainsi dire en deux moitiés fictives : la couronne cède à la noblesse la plus grande part des terrains communaux et du travail des paysans non expropriés; la noblesse abandonne à la couronne la levée des recrues et les impôts des villages et des villes. Le qui s'était enrichi durant cette période de liberté retombe à la misère et au déclassement social.
Les villes doivent ployer sous la force des puissances féodales primitives maintenant alliées, à moins qu'elles ne soient déjà transformées elles-mêmes en centres féodaux comme il arriva pour les cités de l'Italie septentrionale – et même dans ce cas elles tombent le plus souvent au pouvoir de condottieri.
La force offensive de l'adversaire s'accroît à mesure que la force défensive de la ville diminue – car l'aisance citadine naît et meurt avec la puissance d'achat du paysan. Les petites villes tombent dans le marasme, s'appauvrissent et sont livrées sans défense à l'absolutisme princier ; les grandes villes, lorsque la demande d'objets de luxe des seigneurs y encourage une puissante industrie, sont en proie aux divisions intestines et perdent par là leur force politique. L’immigration en masse qui prend place maintenant est exclusivement prolétarienne : soldats congédiés, paysans expropriés, artisans ruinés de la petite ville. Pour la première fois « l'ouvrier libre » de la terminologie marxiste apparaît en masse sur le marché du travail de la ville. Et dès lors la loi d'agglomération des fortunes et des classes entre de nouveau en vigueur et déchire la population municipale en de violentes luttes de classe, dont le résultat le plus clair est d'assurer presque toujours la domination du souverain. Seuls quelques Etats Maritimes, Etats Urbains au vrai sens du mot, purent se soustraire d'une façon durable à l'étreinte implacable de la souveraineté.
Une fois de plus, comme il arriva dans les Etats Maritimes, l'axe de la vie de l'Etat se trouve déplacé. Il se meut maintenant non plus autour de la richesse foncière mais autour de la richesse capitaliste, car la propriété foncière est, elle aussi, devenue capital. Pour quelles raisons l'évolution n'aboutit-elle pas, dès lors, comme dans les Etats Maritimes, à l'économie esclavagiste capitaliste ?
Il y a à cela deux raisons décisives, l'une intérieure, l'autre extérieure. La raison extérieure est qu'une traite lucrative est à peine possible lorsque, comme c'est le cas en Europe, presque toutes les contrées dans un rayon donné sont également organisées en puissants Etats. Là où les conditions sont favorables, comme par exemple dans les colonies américaines des Européens occidentaux, l'esclavage apparaît immédiatement.
La raison intérieure est que le paysan, au contraire de ce qui se passe dans l'Etat Maritime, ne paie pas le tribut à un seul maître, mais à deux au moins[9] : le propriétaire et le souverain. Tous deux se surveillent jalousement afin de conserver au paysan le reste de capacité prestative nécessaire à leurs intérêts. Ce furent surtout les princes les plus forts, comme par exemple ceux de Prusse-Brandebourg qui protégèrent le plus le paysan. Aussi ce dernier, bien que déplorablement exploité, demeure néanmoins sujet légal et libre de sa personne dans toutes les contrées où le système féodal était entièrement développé lorsque intervint l'économie monétaire.
La justesse de cette explication ressort clairement de l'examen des conditions régnant dans les Etats que l'économie monétaire surprit avant l'évolution complète du système féodal. Ce sont surtout les anciens territoires slaves de l'Allemagne et en particulier la Pologne. Là, la féodalité n'avait pas encore savamment échafaudé son système, lorsque la demande de céréales des grands centres industriels de l'Ouest transforma subitement le chevalier, sujet de droit public, en propriétaire foncier, sujet privé. Le paysan n'était donc soumis qu'à un seul maître, son seigneur, et de là sont nées ces « républiques aristocratiques » déjà étudiées dans ces pages, qui se rapprochent de l’économie esclavagiste capitaliste autant que le permet la pression des voisins plus avancés politiquement[10].
Ce qui suit maintenant est si universellement connu que nous pouvons nous borner à de brèves indications. L'économie monétaire devenue capitalisme crée une classe nouvelle à côté de la propriété foncière. Le capitaliste réclame l'égalité de droits et l'obtient finalement grâce à l'aide de la plèbe qu'il soulève et mène à l'attaque de l'ancien régime – au nom du « droit naturel » bien entendu. A peine les représentants de la richesse mobilière, la classe de la bourgeoisie, a-t-elle remporté la victoire qu'elle renverse les armes, conclut la paix avec son ancien adversaire et combat désormais la plèbe au nom de la « légitimité » ou tout au moins d'un mélange suspect d'arguments légitimistes et simili-libéraux.
Tel a été le développement graduel de l'Etat : de l'Etat de brigands primitifs à l'Etat Féodal Développé, à l'Absolutisme et enfin à l'Etat constitutionnel moderne.
L'Etat constitutionnel moderne
Examinons maintenant un peu plus en détail la statique et la dynamique de l'Etat moderne.
Il est encore en principe ce que furent l'Etat de brigands primitif et l'Etat Féodal Développé. Seul un nouvel élément y est entré qui est destiné à représenter dans la lutte des intérêts de classe l'intérêt commun de l'entité d'Etat : cet élément, c'est le fonctionnarisme. Nous examinerons plus loin jusqu'à quel point cet élément se montre à la hauteur de sa tâche. Tout d'abord nous étudierons l'Etat dans les traits caractéristiques qu’il a apportés de ses degrés primitifs.
Sa forme est toujours la domination, son essence l’exploitation du moyen économique, celle-ci limitée toujours par le droit civil qui d'une part protège la « distribution » traditionnelle de la production nationale et d'autre part tend à maintenir les contribuables dans leur pleine capacité prestative. La politique intérieure de l'Etat se meut toujours dans l'orbite que lui prescrit le parallélogramme des forces, force centrifuge de la lutte de classe et force centripète du commun intérêt politique ; sa politique extérieure est toujours déterminée par l'intérêt de sa classe dominatrice, laquelle comprend maintenant outre le « landed », le « moneyed interest ».
Il existe toujours en principe deux classes distinctes : une classe dominatrice à laquelle échoit une part de la production totale du labeur populaire (du moyen économique) supérieure à sa propre contribution productive ; et une classe dominée à laquelle revient une part de cette production, inférieure à sa propre contribution. Chacune de ces classes se subdivise à son tour selon le degré du développement économique en classes et couches secondaires plus ou moins nombreuses, se rangeant d'après les privilèges et les désavantages des lois de distribution qui les régissent.
Dans les Etats d'organisation supérieure, il s'est glissé entre les deux classes principales une classe de transition qui peut être également subdivisée. Les membres ont des obligations envers la classe supérieure et des droits sur la classe inférieure. Nous trouvons par exemple dans l'Allemagne moderne au moins trois subdivisions dans la classe dominatrice : les grands magnats qui sont en même temps possesseurs de mines et entreprises industrielles; les grands industriels et princes de la finance qui sont souvent aussi gros propriétaires fonciers et fusionnent très vite avec les premiers (princes Fugger, comtes Donnersmarck) ; et enfin les petits gentilshommes. La classe dominée est divisée en petits fermiers, ouvriers des champs ou de fabrique, petits artisans et employés. Les classes de transition sont les classes moyennes : gros cultivateurs, petits industriels et artisans aisés, et aussi tels riches bourgeois dont la fortune n'est pas assez considérable pour surmonter certaines difficultés traditionnelles s'opposant à leur pleine admission dans la classe supérieure (juifs). Les devoirs comme les droits de ces classes moyennes sont rendus et perçus gratuitement : seule la destinée individuelle fait à la longue pencher la balance ; d'elle dépend l'issue de la classe ou de l'individu : admission sans réserve dans la classe supérieure ou entière submersion dans la classe inférieure. Parmi les classes de transition en Allemagne, les grands cultivateurs et les petits industriels sont en ascendant pendant que la majorité des artisans décline. Nous touchons déjà à la dynamique des classes.
L'intérêt de chaque classe met en mouvement une quantité absolue de forces coordonnées, lesquelles tendent avec une vitesse déterminée vers un but déterminé. Ce but est le même pour toutes les classes : le produit total du travail consacré par tous les citoyens à la production de biens. Chaque classe aspire à une part aussi grande que possible du produit national, et comme toutes ont les mêmes désirs, la lutte de classe est l'essence même de toute histoire de l'Etat. Nous laissons de côté intentionnellement les actions collectives engendrées par l'intérêt commun, ces actions ayant été poussées au premier plan avec une partialité exagérée par l'examen historique en vigueur jusqu'à nos jours. Cette lutte de classe se présente historiquement comme une lutte de parti. Un parti est à l'origine et ne peut être de façon durable que la représentation organisée d'une classe. Lorsque par la différenciation sociale la classe se fractionne en plusieurs subdivisions ayant des intérêts particuliers différents, le parti se divise rapidement à son tour en autant de nouvelles fractions qui seront ou alliées ou ennemies selon le degré de divergence des intérêts de classe. Lorsqu’au contraire la différenciation sociale supprime une inégalité, les deux anciens partis se fondent bientôt en un nouveau.
Nous pouvons citer comme exemple pour le premier cas la scission dans le libéralisme allemand des partis bourgeois et antisémites, scission résultant du fait que le premier représente une couche descendante et le second une couche ascendante. Le second cas est caractérisé par la fusion politique qui rassemble les petits hobereaux de l'Est et les grands cultivateurs de l'Ouest en une confédération : la ligue des agriculteurs (Bund der Landwirte). Les premiers s'abaissent pendant que les seconds s'élèvent sur l'échelle sociale, et ils se rencontrent forcément à mi-chemin. Toute politique de parti n'a qu'un seul but : procurer à la classe représentée la plus grande part possible de la production nationale. Les classes privilégiées veulent maintenir leur part à l'ancien niveau au moins et la porter si possible à un maximum ne laissant aux exploités que la capacité prestative (comme dans l'Etat-Apiculteur primitif), se réservant la totalité de la plus-value de production du moyen économique, plus-value qui augmente prodigieusement avec l'accroissement de la population et la division du travail ; le groupe des classes dominées veut réduire son tribut à zéro si possible et consommer lui-même la totalité de la production nationale ; et les classes intermédiaires veulent diminuer autant que possible le tribut payable aux classes supérieures et augmenter autant que possible le revenu gratuit prélevé sur les classes inférieures.
Tel est le but, telle est la substance de la lutte de parti. La classe dirigeante combat avec toutes les armes que lui donne l'autorité acquise. Elle décrète les lois servant ses desseins (législation de classe) et les applique de telle sorte que le tranchant du couperet soit toujours dirigé vers le bas, le dos toujours vers le haut (justice de classe). Elle dirige l'administration de l'Etat dans l'intérêt de ses égaux, leur réservant d'emblée toutes les positions prépondérantes procurant influence et profit (armée, administration supérieure, justice) et faisant manœuvrer ensuite à son gré la politique de l'Etat par ces fonctionnaires, ses créatures (politique de classe : guerres commerciales, politique coloniale, politique ouvrière, politique électorale, etc.). Tant que l'aristocratie est au pouvoir, elle exploite l'Etat comme un domaine seigneurial : dès que la bourgeoisie tient le gouvernail, elle l'exploite comme une fabrique. Et la religion de classe couvre le tout de son « tabou ».
Le droit civil contient encore en Allemagne nombre de privilèges politiques et économiques favorisant la classe dirigeante : système électoral ploutocratique, restriction du droit de coalition, règlement pour les domestiques, faveurs de taxation, etc. C'est pourquoi la lutte constitutionnelle qui domine depuis des siècles des siècles la vie politique n’a pas encore pris fin. Elle se livre généralement de façon pacifique dans les parlements, parfois aussi par la violence, au moyen de manifestations, de grèves générales et de révoltes.
Mais la plèbe a compris que la citadelle de son adversaire n'est pas, ou du moins n'est plus, dans ces vestiges des positions de suprématie féodales. Ce ne sont pas des causes politiques mais des économiques qui ont empêché jusqu'à ce jour la transformation radicale du mode de distribution en vigueur dans notre Etat constitutionnel moderne. Aujourd'hui comme jadis, la masse du peuple est plongée dans une noire misère ou subsiste dans une indigence mesquine, livrée à un labeur pénible, écrasant, hébétant ; aujourd'hui comme jadis, une faible minorité, une classe dirigeante composée d’anciens privilégiés et de parvenus accapare, pour le dépenser sans compter, le tribut populaire prodigieusement accru. C'est contre ces causes économiques de la distribution défectueuse qu'est dirigée désormais la lutte de classe entre le prolétariat et les exploiteurs, devenue lutte directe pour l'augmentation des salaires, et dont les armes sont les grèves, le mouvement syndicaliste et l'association. L'organisation économique marche d’abord de pair avec l'organisation politique qu'elle dirige bientôt entièrement. Le syndicat finit par gouverner le parti. C'est le point de développement qu'ont atteint aujourd'hui l'Angleterre et les Etats-Unis.
Avec sa différenciation beaucoup plus compliquée, son intégration plus puissante, l'Etat constitutionnel moderne ne se distinguerait pas foncièrement de ses prédécesseurs, pas plus par la forme que par le fond, si un nouvel élément, le fonctionnarisme, n'était entré en scène.
Le fonctionnaire, étant aux gages de l'Etat, est tenu en principe de rester à l'écart dans la lutte des intérêts économiques; c'est pourquoi dans toute forte bureaucratie la participation aux entreprises lucratives n'est pas considérée comme correcte. Si ce principe était entièrement réalisable et si le meilleur fonctionnaire n'apportait avec lui les opinions politiques de sa classe d'origine, nous aurions véritablement dans le fonctionnarisme cette dernière instance conciliante et dirigeante, planant au-dessus de la lutte des intérêts, et capable de guider l'Etat vers ses nouvelles destinées. Là serait sans conteste le point d'appui réclamé par Archimède, le point d'appui grâce auquel le monde de l'Etat pourrait être soulevé.
Malheureusement le principe n'est pas entièrement réalisable et les fonctionnaires ne sont pas encore de pures abstractions sans sentiment de classe. D'abord, la participation à une forme d'entreprise, l'agriculture, est considérée comme la plus haute qualification du fonctionnaire dans tous les Etats où prédomine l'aristocratie foncière ; puis, de puissants intérêts économiques agissent sur la plupart d'entre eux, et précisément sur les plus influents, les entraînant dans la lutte, inconsciemment et comme malgré eux. L'aide matérielle reçue des parents ou beaux-parents, les propriétés héréditaires, les attaches de famille avec les possesseurs du « moneyed » ou du « landed interest » fortifient le sentiment inné de solidarité avec la classe dirigeante dont ces fonctionnaires sortent presque tous.
S'il était possible de supprimer les relations économiques de ce genre, cette solidarité serait aisément remplacée par le pur intérêt de l'Etat.
Aussi est-ce en général dans les Etats pauvres que nous trouvons les fonctionnaires les plus capables, les plus désintéressés et les plus impartiaux. C'est avant tout à sa pauvreté que la Prusse a dû autrefois cet incomparable corps de fonctionnaires qui la guida si sûrement à travers tous les écueils. Ses membres étaient d'ordinaire entièrement étrangers à toute pensée de gain, direct ou indirect.
Ce fonctionnarisme idéal est moins fréquent dans les Etats riches. L'évolution ploutocratique entraîne fatalement l'individu dans le tourbillon, lui enlève un peu de son objectivité, de son impartialité. Néanmoins l'institution remplit toujours d'une façon passable la tâche qui lui est échue : défendre l'intérêt collectif contre l'intérêt de classe. Et involontairement, ou du moins inconsciemment, elle le défend de telle sorte que le moyen économique qui la créa est encouragé dans sa marche lente mais sûre contre le moyen politique. Sans doute les fonctionnaires exercent la politique de classe que leur prescrit la constellation des pouvoirs dans l'Etat, sans doute ils ne sont au fond que les représentants de la classe dirigeante dont ils sortent ; mais ils adoucissent l'âpreté du combat, ils répriment les excès, ils obtiennent les modifications du droit, mûries par le progrès social, avant que la lutte ouverte ne s'engage. Dans les pays gouvernés par une forte lignée de princes dont le chef, comme le Grand Frédéric, se considère comme le premier fonctionnaire de l'Etat, ce que nous avons observé à propos du fonctionnarisme en général s'applique plus essentiellement encore au souverain. Son intérêt, en effet, comme usufruitier héréditaire de la nue-propriété de l'Etat, lui commande avant tout d'en affermir les forces centripètes, en affaiblissant les forces centrifuges.
Nous avons souvent en l'occasion, an cours de cette étude, d'apprécier la solidarité entre le prince et le peuple en tant que force historique bienfaisante. Dans l'Etat constitutionnel parfait, où le monarque n'est plus qu'à un degré infinitésimal sujet économique d'ordre privé et demeure presque entièrement fonctionnaire, cette communauté d'intérêts a un poids beaucoup plus grand encore que dans l'Etat féodal ou que dans l'Absolutisme, où la souveraineté est encore partiellement propriété privée.
La forme extérieure du gouvernement n'est pas d'une importance prépondérante dans l'Etat constitutionnel. Dans une république comme dans une monarchie, la lutte de classe est menée par les mêmes moyens et conduit au même but. Néanmoins ceteris paribus, dans la monarchie, la courbe de l'évolution de l'Etat sera vraisemblablement plus allongée et moins riche en inflexions secondaires ; le prince, moins affecté par les courants quotidiens que ne l'est le président, élu pour une brève période, redoute moins une diminution passagère de popularité et peut par suite étendre sa politique sur de plus longues périodes.
Il nous reste à mentionner une variété du fonctionnarisme dont l'influence sur l'évolution supérieure de l'Etat ne doit pas être négligée : le fonctionnarisme scientifique des universités. Il n'est pas seulement une création du moyen économique comme le fonctionnarisme en général, il représente en même temps une force historique que nous n’avons connue jusqu’ici qu’en sa qualité d'alliée de l'Etat conquérant : le besoin causal.
Nous avons vu ce besoin à l'époque primitive créer la superstition ; nous avons trouvé son bâtard, le tabou, employé partout comme arme puissante entre les mains des maîtres. De ce même besoin la science est née, la science qui désormais attaque victorieusement la superstition et prépare la voie de l'Evolution. C'est là l'inestimable service rendu par la science et en particulier par les universités.
Notes
- ^ Acte par lequel un homme libre pouvait se « recommander » à un plus puissant que lui, se placer dans sa dépendance pour en obtenir protection et, parfois, nourriture. Ce fut, pendant le haut Moyen Âge (VIe-IXe s.), l'origine de la féodalité. À l'époque mérovingienne, cette commendatio affecte des hommes de tout rang qui obtiennent ainsi d'un plus puissant (laïc, ou institution ecclésiastique) soit la confirmation de leur droit de propriété sur une terre, soit la jouissance d'une terre attribuée lors de la commendatio (c'est le beneficium, ou bienfait). Moyennant ces avantages générateurs d'une appréciable protection, le « recommandé » doit à son seigneur un certain nombre de prestations (service militaire, aide économique, conseil et assistance).
- ^ « Autour des lieux du culte proprement dit viennent toujours se grouper des demeures pour les prêtres, des écoles et des asiles pour les pèlerins. » (Ratzel, l ch. II.) Tout pèlerinage important devient naturellement le centre d'un marché florissant. Il est à noter qu'en allemand les grandes foires de commerce s'appellent, du nom de la cérémonie religieuse, des « Messen ».
- ^ « Le tiers réjouit », expression qui fait référence à une situation où un tiers profite du conflit qui oppose deux groupes. Cette formule est due au sociologue allemand Georg Simmel.
- ^ Eisenhart, Geschichite der National-Oeconomie, p. 9 : « Grâce à ce nouveau moyen de paiement plus maniable il devint possible d’avoir un corps plus dépendant de militaires et de fonctionnaires. La méthode de paiement régulier ne leur permettait plus de se rendre indépendants du maître commun ou de se tourner contre lui ».
- ^ Thurnwald , 1 , ch., p. 773.
- ^ Id. 1, ch., p. 699.
- ^ Id. 1, ch., p. 709.
- ^ Thurnwald, 1. ch., p. 711.
- ^ En Allemagne, pendant le moyen âge, le paysan payait l'impôt non seulement au seigneur et au suzerain, mais aussi au séneschal (Obermaerker) et au bailli.
- ^ Cf. Oppenheimer, Grossgrunrfeigentum, etc., L. II, ch. 3.